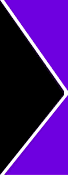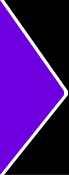Longtemps méprisé par la critique, Mario Bava est considéré aujourd’hui comme le maître du cinéma fantastique italien et le créateur du thriller à l’italienne, le giallo. Souvent cité par John Carpenter, Martin Scorcese, Dario Argento ou Tim Burton comme une influence majeure de leurs œuvres, il reste encore aujourd’hui un réalisateur peu connu du grand public.
Dans le livre Le magicien des couleurs, les auteurs Gérald Duchaussoy et Romain Vandestichele nous emmènent au cœur des créations parfois morbides de ce réalisateur génial.
Interview
Qu’est-ce qui rend Mario Bava si insaisissable ?
Il nous semble que son cinéma se livre peu en effet, en tout cas au premier abord, surtout pour un cinéma d’exploitation, qui a vocation à être consommé immédiatement. Or, de par son traitement « habité » de la lumière et des couleurs, l’œil du spectateur est tout de suite charmé. D’où une étrange attirance qui nous laisse en dehors du film que nous sommes en train de voir dans un sentiment contraire. Il titille, Bava !
Son œuvre a longtemps été difficilement accessible, car ses films passaient dans des petits circuits, et ils n’étaient peu ou pas distribués. Dans les années 60-70, pendant lesquelles Bava a exercé en tant que réalisateur, il n’y avait que le circuit des salles et très peu de cases sur les chaînes de télévision pour les films de genre. Et il était difficilement perceptible dans le paysage cinématographique, pour les mêmes raisons, loin des honneurs et de la reconnaissance dévolus aux « grands », comme Fellini ou Antonioni.
«Mario Bava savait tout faire»
Pourquoi Mario Bava était-il très respecté dans le milieu du cinéma mais méprisé par la critique ?
Il n’a jamais été bien considéré par la critique, à part dans certaines publications comme Midi-Minuit Fantastique et Positif, qui avait fait sa couverture du Masque du démon (La maschera del Demonio, 1960), son premier film. Ce qui est étrange, c’est que même les revues spécialisées ne tardèrent pas à l’éreinter. Ainsi, encensé pour Le masque du Démon, il sera dès l’année suivante en butte aux critiques déplorant son utilisation des couleurs dans Hercule contre les vampires (Ercole al centro della terra, 1961) ; alors même que son art s’exprimera pleinement à travers la couleur, les couleurs devrait-on dire.
Le pendant de ce mépris était un respect sans failles dans le milieu du cinéma, car Mario Bava savait tout faire, des effets visuels à la photographie (son premier métier lorsqu’il débuta en 1939, sur le court métrage Il tacchino prepotente, de Roberto Rossellini), en passant par le montage et le choix des filtres et lentilles.
« Il considérait avec raison que l’art pouvait et devait être populaire »
Mario Bava est souvent relié au cinéma d’exploitation. Peut-on tout de même le considérer comme un auteur ?
La cohérence de son œuvre le place indéniablement dans la position d’un auteur à part entière… même s’il s’en défendait vigoureusement, allant jusqu’à dénigrer ses films et l’industrie du cinéma toute entière, qu’il qualifia de « carnaval absurde [qu’il ne pouvait] prendre au sérieux » (dans une interview de 1971, donnée au magazine Horror). On peut certes y voir une pose mais l’homme faisait preuve d’une réelle humilité face à son travail, se qualifiant volontiers d’artisan plutôt que d’artiste.
On peut affirmer que Mario Bava était un lettré, un amoureux des arts en général et de la peinture en particulier, officiant dans un art populaire, sans que cela soit en aucune façon péjoratif. Il considérait avec raison que l’art pouvait et devait être populaire, donc accessible. Sans pour autant laisser de côté une recherche formelle, esthétique, que d’aucuns prétendent encore aujourd’hui incompatible avec un art populaire. Maîtriser la technique, les filtres, les couleurs, le cadre, les décors, le montage, le scénario, le jeu des acteurs, cela revient à dire que le metteur en scène est démiurge, un rôle renforcé par la faiblesse des moyens financiers dont disposait Bava, ce qui l’arrangeait bien car cela lui permettait de tout contrôler. Cela inclut l’aspect thématique, on retrouve quasiment tout le temps ses obsessions pour les meurtres baroques et brutaux, l’enfermement (des personnages et du spectateur-voyeur), de la résonance auditive et cognitive, de la couleur en forme de traits croisés, exploitée comme un propos radical (d’où le titre de notre livre Le Magicien des couleurs) et sa vision du monde empreinte de misanthropie, voire d’apanthropie.
Les personnages de ses films semblent déshumanisés, agissant comme des figurines. Pensez-vous que Mario Bava était misanthrope ?
Nous avons abordé le sujet dans notre livre car cela nous semblait effectivement un trait caractéristique du cinéma de Mario Bava : l’utilisation des acteurs et actrices comme des pupazzi (pantins) plus que comme des interprètes. Il peuplait ses cadres en utilisant la matière humaine, choisissant Barbara Steele pour Le masque du Démon parce qu’elle avait « un air étrange ». La psychologie des personnages n’est pas primordiale : leurs actes et les conséquences qui en découlent le sont bien plus, dans une forme d’observation des gesticulations des humains livrés à leurs passions.
Plus que misanthrope, il pose en quelque sorte un regard d’entomologiste sur une petite communauté d’individus qui vont invariablement – ou presque – finir par s’autodétruire. De ce fait, il est vrai que les personnages sont parfois déshumanisés, mais cela correspond la plupart du temps à une thématique forte (que l’on n’attendrait pas forcément dans un film dit « de genre ») : la vanité de l’existence humaine, qui transpire dans chaque plan de L’île de l’épouvante (en particulier dans ceux qui se déroulent dans la chambre froide, accompagnés de l’immanquable petite ritournelle (intitulée Fantoccio grottesco…) ou de La baie sanglante, les deux films formant une sorte de diptyque qui annonce le nihilisme forcené de Cani Arrabiati, l’avant-dernier film de Bava et son plus noir.
Nous ne pensons donc pas que Mario Bava fut misanthrope. Tous les témoignages le présentent d’ailleurs comme un homme aimable, humble, cultivé et aimant partager. Il est en revanche évident que les acteurs et actrices n’étaient pas ses préoccupations premières : il était une sorte de démiurge pour qui la narration passait par le contrôle complet de l’image, le jeu devenant secondaire, que ce soit la justesse ou même les dialogues (cela rejoint la vision d’un autre démiurge, Federico Fellini, qui disait à ses acteurs de compter s’ils ne connaissaient pas leurs dialogues ou ne parlaient pas bien italien: de toute façon, tout serait post-synchronisé…). Cela n’empêcha pourtant pas de nombreux acteurs et actrices de vouloir jouer dans ses films et même de le suivre sur plusieurs, formant une sorte de « famille » de cinéma qui connaissait la manière de fonctionner du « chef de famille », et qui travaillait ainsi plus vite et plus efficacement sur les tournages.
Les films de Mario Bava sont comme des micro-mondes. Il n’y a pas souvent de regard extérieur pour nous aider à y entrer. Est-ce que cela pourrait expliquer la particularité de son cinéma ?
L’idée de « micro-mondes » est effectivement très pertinente. Elle retranscrit très bien cette idée de cloche sous laquelle évolueraient des personnages, jouant devant nous, indifférents au monde que nous connaissons. Elle rejoint indubitablement la notion que nous avons développée dans le livre pour tâcher de définir son travail: l’« ultra-cinéma ». Le huis-clos insulaire de L’île de l’épouvante (Cinque bambole per la luna d’Agosto, 1970), la « maison de poupées » de Rosie/Michèle Mercier dans Le téléphone, premier segment des Trois visages de la peur (I tre volti della paura, 1963), l’angoissant road-trip claustrophobique de Cani arrabiati (1974), etc.
Ce ne sont que quelques exemples de la capacité qu’avait Mario Bava à créer des univers clos, fussent-ils en extérieur comme dans La baie sanglante (Reazione a catena/Ecologia del delitto, 1971). On y décèle un enfermement éprouvant et étouffant, également très plaisant du point de vue de l’amateur. Ces univers finis s’accompagnent d’un regard unique et sobre, celui de la caméra toute puissante. Dans le cinéma de Bava, rien ne vient distraire l’attention du spectateur et le faire rebasculer dans le réel. Le réalisateur était un maître des techniques et un esthète accompli, deux qualités qui lui permettaient de prendre le contrôle à travers la fascination provoquée par la beauté de ses images, explosions de couleurs et de noirceur profonde, attrayantes et violentes, sexy ou scabreuses: la beauté du diable, en somme.
« Les explosions de couleurs sont une caractéristique majeure de ses films »
Mario Bava projetait très souvent des couleurs à l’écran, comme le rouge, le violet ou le bleu. Pourquoi faisait-il ça ?
On peut voir l’influence des flamboyances gothiques des films de la Hammer, principalement ceux de Terence Fisher, dans l’utilisation des couleurs dans les films gothiques « all’italiana » des années 60 : on peut citer Riccardo Freda, avec L’effroyable secret du Docteur Hichcock (1962), ou Antonio Margheriti, avec La Vierge de Nuremberg (1963). La filiation est bien entendu aussi légitime pour Mario Bava. Il vint au cinéma dans la continuité de son père, Eugenio, l’un des plus grands directeurs de la photo et réalisateur d’effets visuels du cinéma muet italien. Il travailla entre autre sur Cabiria, de Giovanni Pastrone en 1914, année de la naissance de Mario. Il faut surtout dire que les influences majeures de Bava viennent de la peinture (il voulait devenir peintre et avait fait les Beaux-Arts), d’où certainement cette fascination de la couleur.
Les explosions de couleurs sont une caractéristique majeure de ses films et l’utilisation assez inédite des gélatines dans le cinéma italien produit une distanciation immédiate avec le réel. Plus que l’expression d’un symbolisme somme toute assez simpliste et réducteur si l’on considère son œuvre dans son intégralité, les couleurs chez Bava permettent d’entrer de plain-pied dans un monde onirique où nos sens sont mis à rude épreuve. L’application du réalisateur à perdre le regard du spectateur allant de pair avec le travail du son, on peut parler d’art sensuel : le vent (Le corps et le fouet), le cri (Cani arrabiati, Hercule contre les vampires), la voix (Le téléphone), la déformation de sons a priori anodins (La goutte d’eau), etc. Ainsi, l’utilisation de couleurs « exagérées » est indissociable de celle de sons déformés : cela forme une esthétique des sens qui induit le doute, la peur, et provoque le cauchemar.
Chez Bava, la mort et le sexe sont souvent liés. Peut-on parler de cinéma morbide ?
L’érotisation de la mort est effectivement un élément important pour comprendre le cinéma de Mario Bava, car c’est un cinéma de pulsions ! Dans ses films, elles animent les protagonistes. Ils se laissent aller, en même temps que le spectateur, à sombrer dans des cauchemars, au sens premier du terme. Mario Bava s’inscrit dans la continuité d’un fantastique gothique littéraire et cinématographique qui, du Dracula de Bram Stoker à celui de Terence Fisher, parle à nos sens avant de s’adresser à notre raison, en tant que lecteurs ou spectateurs.
Il y a donc effectivement un aspect vénéneux, sinon morbide, dans le cinéma de Mario Bava. Il lie souvent le sexe et la mort, voire en fait un argument pour dérouler un cauchemar nécrophile où les errements des personnages tiennent lieu de scénario et où la cohérence visuelle et sonore (les couleurs, à nouveau, et le son du vent omniprésent, tel un protagoniste à part entière) tient lieu de narration : c’est, en 1962, Le corps et le fouet, avec Christopher Lee. Mais l’érotisme joyeux et décomplexé existe aussi chez Bava : le meilleur exemple en serait Danger, Diabolik où il est évident que sexe et mort sont à nouveau liés mais dans une vision anarchiste de la société de consommation en formation et sans le moindre élément de morbidité.
« La plupart des photos de tournage que nous connaissons de lui, le montre en train de faire le pitre »
On a le sentiment que Mario Bava se camouflait derrière ses films…
Médiatiquement, Bava ne cherchait pas l’exposition. On trouve très, très peu d’interviews, de photos ou d’entretiens avec lui. Il se considérait avant tout comme un artisan, comme le vecteur de son art, et avait un recul conséquent quant au milieu du cinéma. Donc oui, on peut dire qu’il se camouflait derrière ses films. À plusieurs titres, d’ailleurs. Outre cette vision de lui-même comme étant au service de son art, on peut penser qu’il y avait une volonté de ne pas s’exposer, de ne pas se révéler : il est intéressant, à ce titre, de noter que la plupart des photos de tournage que nous connaissons nous le montre en train de faire le pitre, déguisé ou grimaçant, faisant mine d’étrangler Elke Sommer (Lisa et le Diable, 1973)…
Comme s’il avait effectivement eu le désir de se dissimuler. Dès lors, quoi de mieux pour se masquer (on en revient à son œuvre originelle, Le Masque du démon) que d’officier dans un domaine peu ou mal considéré ? C’est ce qu’il fit dans un cinéma d’exploitation, de « filones », tout en développant des thèmes que l’on avait l’habitude de voir dans des films dits « d’auteurs », plus appréciés par la critique: destruction de la cellule familiale (La planète des vampires, Les Wurdalaks…), névroses insurmontables d’une société post-industrielle (Shock, 1977 ; La baie sanglante, 1971), désir d’hédonisme et de libérations dans une société bridée par la morale et la consommation (Danger, Diabolik!), perte des repères et incommunicabilité (Il rosso segno della folia, 1970 ; Cani arrabiati, 1974), etc.
« Il y a des similitudes frappantes entre le scénario de La planète des vampires et celui d’Alien »
Comment se fait-il que notre regard sur ses films ait changé ?
Mario Bava a toujours été l’objet d’un amour inconditionnel de la part de cinéphiles de tous bords, pas forcément des fans de genre au sens où on l’entend maintenant, tous dévoués à la cause des monstres, vampires et autres assassins gantés. Il est vrai cependant qu’il n’était pas très connu du grand public et que, ces dernières années, ses œuvres sont (re)découvertes par de plus en plus de gens. Il commence à être enfin reconnu à sa juste valeur.
On peut avancer plusieurs raisons à cette nouvelle et assez large exposition. Tout d’abord, l’accessibilité et une sorte d’effet boule de neige: les différents supports ont considérablement évolué et il est maintenant plus facile de voir des films de genre qu’à l’époque de la VHS. Ce qui nous amène à la réédition des films en Blu-ray par de nombreux – petits – éditeurs auxquels il convient de rendre hommage, tellement leur travail contribue à étoffer une histoire du cinéma encore bien trop consensuelle.
On peut aussi considérer que son cinéma a infusé les genres populaires, jusqu’à être repris dans des œuvres au succès planétaire. Il y a par exemple des similitudes frappantes entre le scénario de La planète des vampires (Terrore nello spazzio, 1965) et celui d’Alien (1979). Ce qui nous amène à une autre raison au regain d’intérêt pour les films de Mario Bava : l’influence directe, au niveau purement visuel, sensuel, qu’il a eu sur une, voire deux générations de cinéastes. Cela n’est pas un hasard s’il est régulièrement cité par John Carpenter, Martin Scorcese, Dario Argento ou Tim Burton. On peut aussi citer Nicolas Winding Refn et Sam Levinson, deux cinéastes chez qui l’utilisation des couleurs (mais pas uniquement: on peut aussi détailler certains cadrages particuliers ou des routines de montage) montre à quel point l’influence de Bava est intégrée et assumée.
Pourquoi faut-il redécouvrir les films de Mario Bava aujourd’hui ?
Les films de Mario Bava sont souvent des matrices du cinéma populaire mondial des années 70 à nos jours. Regardons, pour nous en convaincre, Alien (Ridley Scott), Dark Star, Halloween (John Carpenter), Sleepy Hollow (Tim Burton), Pulsions (Brian De Palma), Valhalla Rising (Nicolas Winding Refn), Assassination Nation (Sam Levinson), et tant d’autres. On en vient à se demander si Bava n’est pas un réalisateur pour réalisateurs ! Comme si eux avaient pleinement conscience de ce qu’il transmet et du fait qu’il s’adresse en priorité aux conteurs de l’image. Cela permet, en outre, de réfléchir au statut de la couleur et de ce qui est en train de changer avec le numérique et la post-production en numérique, sur ordinateur plutôt qu’en éclairage plateau, puis en laboratoire dans des bains qui sont devenus des processeurs. Et bien sûr d’avoir peur !
Par quel film commencer ?
Nous recommanderions de commencer par 6 Femmes pour l’assassin en raison du fait qu’il s’agit d’un whodunit donc que l’on peut se raccrocher facilement à l’intrigue pour mieux se laisser bercer par la petite musique lancinante qui va nous mener vers la mort.
Il s’agit du septième film en quatre ans du réalisateur italien Mario Bava, ce qui vous laisse imaginer aisément l’agilité et la productivité du réalisateur qui occupait un bon nombre de postes sur le plateau. Il avait déjà posé dans La Fille qui en savait trop en 1963 et dans le film à sketches Les Trois visages de la peur en 1963, année où réalise coup sur coup trois films à la maestria manifeste, les bases de ce que l’on va appeler le « giallo ». Film policier, film d’enquête, film meurtrier, le genre adopte un fétichisme où seuls apparaissent des mains gantées, des tueurs sans visage et des lames infernales à la recherche de jeunes femmes à l’allure d’ange. Tel ce 6 Femmes pour l’assassin où la maison de couture, lieu principal du film, nous enferme dans une mise en scène magistrale où les formes du mal et de la beauté se mêlent pour notre plus grand plaisir, surtout pas coupable !
Le magicien des couleurs de Gérald Duchaussoy et Romain Vandestichele, aux éditions Lobster